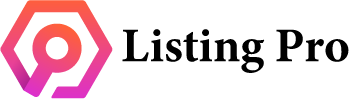Pourquoi une entreprise choisit-elle de se mettre en sommeil ?
Imaginez le scénario : après quelques années de bons et loyaux services, votre entreprise navigue dans une mer devenue un peu trop calme. Les vents économiques ne sont plus favorables, votre motivation s’essouffle, ou vous souhaitez tout simplement explorer d’autres horizons sans pour autant saborder le navire. Que faire alors ? C’est ici qu’intervient la mise en sommeil : une opération légale, simple en apparence, mais chargée d’enjeux.
Mettre en sommeil son entreprise, c’est comme appuyer sur « pause » sans pour autant la supprimer du jeu. Elle reste enregistrée, mais cesse temporairement son activité. C’est une alternative à la dissolution, et souvent une bouée de sauvetage pour les entrepreneurs qui préfèrent temporiser avant de trancher. La création d’entreprise étant un sport de haute voltige, on peut comprendre ce besoin de souffler, tout en gardant une porte ouverte pour plus tard.
Qu’est-ce que la mise en sommeil d’une entreprise ?
La mise en sommeil, également appelée cessation temporaire d’activité, désigne la situation dans laquelle une société arrête volontairement son activité sans se dissoudre. À ce stade, elle conserve sa personnalité juridique, sa structure administrative, mais ne génère plus d’activité économique.
Elle peut concerner aussi bien une SAS, une SARL, une EURL qu’une microentreprise. Cette option est souvent envisagée lorsqu’un dirigeant :
- Souhaite suspendre temporairement son activité faute de rentabilité ou de clients.
- Prend un congé sabbatique pour tester une autre idée ou faire le point sur sa carrière.
- Anticipe une cession future mais dans de meilleures conditions.
À la différence d’une radiation définitive, la mise en sommeil vous permet de garder la main. Un peu comme mettre son entreprise dans un caisson d’hibernation, en attendant que la situation évolue.
Quelles sont les démarches à réaliser auprès de l’URSSAF et du greffe ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, mettre en sommeil son entreprise ne se limite pas à simplement « lever le pied ». Il y a des étapes administratives à respecter, et le passage par l’URSSAF fait partie du tableau.
Mise en sommeil pour les travailleurs indépendants (auto-entrepreneurs / TNS)
Pour les auto-entrepreneurs ou les travailleurs non-salariés (TNS), la procédure s’effectue directement auprès du centre des formalités des entreprises (CFE) compétent, qui transmettra l’information à l’URSSAF. En pratique :
- Vous remplissez un formulaire de cessation temporaire d’activité (formulaire P2 pour les entreprises individuelles).
- Vous déclarez cette mise en sommeil dans les 30 jours qui suivent l’arrêt d’activité.
- L’URSSAF maintiendra vos obligations déclaratives tant que l’entreprise n’est pas radiée.
Mise en sommeil pour les sociétés (SARL, SAS, EURL…)
Ici, le chef d’entreprise doit notifier la décision de mise en sommeil au greffe du tribunal de commerce, dans un délai d’un mois après arrêt d’activité. Les pièces à fournir sont entre autres :
- Un formulaire M2 dûment rempli.
- Un procès-verbal de décision (gérant ou assemblée) mentionnant la mise en sommeil.
- Des frais de greffe (environ 190 € selon les structures).
Cette déclaration est ensuite enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), et la mention « société en sommeil » apparaît sur l’extrait Kbis. Voilà, l’entreprise est inactive, mais pas inerte.
Quelles conséquences fiscales et sociales engendre la mise en sommeil ?
Attention : mettre son entreprise en sommeil ne signifie pas qu’on disparaît des radars ! Sur le plan administratif, certaines obligations persistent. Et elles peuvent surprendre plus d’un entrepreneur mal préparé.
Cotisations URSSAF : on ne coupe pas le cordon
Pour les indépendants, même sans chiffre d’affaires, vous restez redevable des cotisations sociales minimales. Oui, cela peut sembler incohérent, mais c’est le jeu : tant que l’entreprise existe, l’URSSAF la considère comme active… administrativement parlant.
En revanche, si vous demandez l’exonération ou l’ajustement des cotisations, vous devez en faire la demande expresse auprès de l’URSSAF. Il n’y a pas de suppression automatique.
Déclarations fiscales : rester dans les clous
Même sans activité, les déclarations fiscales doivent continuer d’être déposées : TVA (le cas échéant), déclarations de résultats, liasse fiscale… Sinon, bonjour les amendes.
Un conseil : prévoyez une comptabilité simplifiée pendant la période de sommeil, mais ne la négligez pas. Rien de pire que de réactiver une société en découvrant une montagne de pénalités.
Combien de temps peut durer une mise en sommeil ?
La durée légale maximale est de deux ans, renouvelable uniquement en cas de réactivation ou de radiation volontaire. Passé ce délai, si l’entreprise n’a pas été réactivée ni officiellement dissoute, le greffe peut procéder à sa radiation d’office. Et cela peut poser des complications, notamment pour céder le fonds, liquider les actifs ou reconstituer les historiques…
Moralité ? Lorsque vous mettez votre société en sommeil, fixez-vous une alerte au bout de 18 mois maximum. Cela vous laisse le temps de planifier un réveil… ou un dernier au revoir en bonne et due forme.
Mise en sommeil rime-t-elle avec embuscade ? Les pièges à éviter
Une erreur fréquente est de croire qu’en sommeil, l’entreprise n’existe plus : faux. Elle continue d’être assujettie à certaines charges, au minimum administratives. Un chef d’entreprise m’a un jour raconté qu’il avait mis sa boîte en sommeil pour se lancer dans un projet associatif à l’étranger. Deux ans plus tard, retour à la réalité : 2 000 euros de pénalités pour déclarations non effectuées… pourtant avec zéro activité. Une piqûre de rappel douloureuse, mais utile.
D’autres écueils guettent les entrepreneurs imprudents :
- Oublier de notifier la mise en sommeil dans les délais légaux.
- Ignorer les obligations déclaratives post-sommeil.
- Penser que la simple absence de chiffre d’affaires suffit pour « mettre sur pause ».
Chacun de ces points peut se transformer en surprise salée. D’où l’importance de garder un lien étroit avec son comptable ou son expert juridique pendant cette phase.
Réactiver ou fermer : le choix au réveil
Après la mise en sommeil, vous avez deux chemins devant vous. Reprendre l’activité, ou clôturer définitivement l’entreprise. Dans le premier cas, il suffit de déclarer la reprise d’activité au CFE avec le formulaire M2 ou P2 selon votre statut. Encore une fois, tout passe par l’administratif.
Si la reprise n’est plus envisagée, la dissolution volontaire puis la liquidation s’imposent. Et mieux vaut la faire en connaissance de cause, plutôt que de laisser la société glisser vers une radiation automatique, qui ferme la porte à bon nombre de possibilités (notamment fiscales).
Un outil stratégique, quand bien utilisé
Un entrepreneur averti en vaut deux. Utilisée correctement, la mise en sommeil peut s’avérer être non pas un abandon, mais une stratégie. Elle permet de :
- Gagner du temps pour tester un autre secteur.
- Préserver le nom commercial ou les actifs immatériels.
- Réaliser une transition en douceur avant cession, réorientation ou investissements futurs.
Le marché évolue, et avec lui, nos ambitions aussi. Mettre une entreprise en pause, c’est parfois prendre du recul pour revenir plus fort, ou passer à autre chose avec élégance. Le tout est de rester maître du tempo et de ne pas laisser le sommeil devenir un oubli.
Parce que, dans ce vaste échiquier entrepreneurial, savoir quand avancer, reculer ou temporiser… c’est aussi ça, être un stratège.